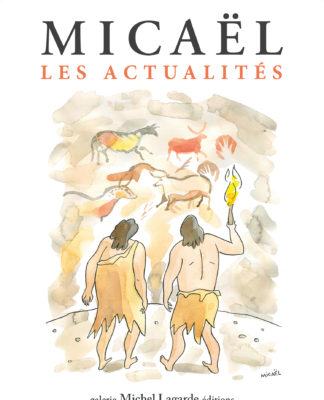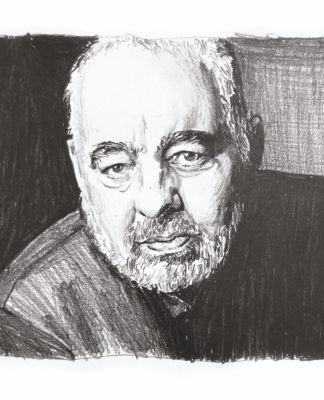Samuel Bollendorff, né en 1974 et formé aux Beaux-Arts de Paris, appartient à cette génération de photojournalistes qui ont dû faire face à la crise de la presse et se sont fédérés sous la bannière du collectif L’œil Public de 1999 à 2010. Ce fut l’une des dernières agences françaises de photographie indépendante.
En 2018, Samuel Bollendorff a fait le tour de la terre. Cela ne prend que quelques heures tant elle est petite. Où que son regard se soit porté, il s’est perdu dans l’obscurité. Un fleuve mort sur 650 km, des forêts radioactives, des enfants nés sans yeux, des trafics de déchets toxiques… Qu’avons-nous laissé faire ? À travers Contaminations, série réalisée en coproduction avec le journal Le Monde (également exposée et bientôt publiée en livre), Samuel Bollendorff nous propose une réflexion sur ces pollutions laissées en héritage pour des décennies, parfois des siècles, aux générations futures.
Michel Lagarde : À quel moment de votre vie décidez-vous de vous lancer sur un sujet aussi important que la contamination de la Terre ? Comment se lance-t-on dans un projet comme celui-ci, et avec quels moyens, quelle idée de départ et quels objectifs ?
Samuel Bollendorff : C’est un projet que j’avais écrit il y a un moment et pour lequel j’essayais d’obtenir des bourses. J’ai eu une première aide de mécènes privés qui soutiennent des travaux sur l’environnement. Cela me permettait de financer la moitié seulement du projet. J’ai alors proposé une coproduction au journal Le Monde qui a complètement adhéré au projet. C’est ce qui m’a permis de traiter l’intégralité du sujet. Ça s’est fait comme ça. En septembre 2017 j’ai reçu mon financement, le projet a été validé en novembre et nous avons réalisé l’ensemble des sujets entre fin janvier et mi-juillet 2018. Dès septembre les images ont été exposées à Visa pour l’Image, avec une parution quotidienne dans le journal pendant sept jours. Une pagination totale de 22 pages. Ensuite, l’exposition a tourné à Paris et dans le sud de la France. Le livre sortira début novembre aux éditions E/P/A. Le projet s’est donc étalé sur deux ans, ce qui est très court, avec six mois sur le terrain, un an avant la première publication dans Le Monde.

Quel a été le déclic décisif d’un tel projet ? Combien d’endroits à visiter et lesquels choisir ?
En 2006, j’étais tombé sur un rapport terrible de l’ONG Blacksmith Institute qui classait les dix villes les plus polluées du monde. Je m’étais dit qu’il y avait quelque chose à faire dessus. En mûrissant mon projet, et aussi en suivant l’actualité, je me suis aperçu que c’était moins sur la pollution urbaine que sur la contamination des sites qu’il fallait travailler, ces lieux où la vie n’allait plus pouvoir se développer normalement pendant des siècles.
Le projet traite évidemment de la radioactivité à Fukushima, mais aussi des PCB de Monsanto à Anniston en Alabama – où encore aujourd’hui des enfants naissent avec douze doigts ou sans yeux–, du taux de cancers qui explose dans le Grand Nord canadien à cause de l’exploitation des sables bitumineux, du Rio Doce au Brésil, contaminé sur plus de 600 kilomètres, des trafics de déchets par la mafia en Italie, des villes d’armement chimique en Russie, et puis évidement de ce qu’on appelle le continent plastique qui est grand comme six fois la France au milieu du Pacifique.
L’idée était de travailler sur des pays riches, comparables au nôtre en termes de puissance économique et de système politique, les États-Unis, le Japon, l’Italie, le Canada, le Brésil ou la Russie : des États qui ont les moyens de relever les défis environnementaux mais décident de ne pas le faire, et voient ainsi des pans entiers de leur territoire contaminés pour des siècles. Je ne voulais pas que l’on puisse se réfugier derrière l’argument selon lequel il est peut-être normal qu’un pays en voie de développement ou une dictature se soucient peu de l’environnement. Non, les pays phares de la planète sont aussi les plus dévastateurs. C’est vraiment une question de lobbys, d’industries tellement puissantes que les politiques ont peur d’agir et laissent faire. Par exemple au Canada où Justin Trudeau, qui passe pour un progressiste, a été contraint de sortir du protocole de Kyoto parce que les industries d’exploitation du pétrole issu des sables bitumineuses y émettent à elles seules autant de gaz à effet de serre qu’un pays comme le Danemark ou l’Irlande. Évidement, ces industries créent de l’emploi et apportent au pays une richesse inouïe, mais pour cela on dévaste les forêts primaires, les émissions de gaz à effet de serre explosent, des Indiens sont tués, les caribous et les canards sauvages disparaissent…
Mon travail préparatoire impliquait de bien réfléchir à la façon dont s’orchestrent les sujets. Il était inutile d’aller à la fois à Tchernobyl et à Fukushima parce que les problématiques sont similaires, même si les deux pays les ont traitées de manières différentes. Par contre, il me semblait important de couvrir plusieurs continents afin d’essayer, sans forcément vouloir être exhaustif, de dresser une sorte de portrait planétaire. Tout cela a fait l’objet d’un projet écrit, d’une pré-enquête. C’est ce que j’ai présenté au Monde pour démarrer. Ensuite, nous avons travaillé avec le service Planète du journal : sept journalistes, chacun spécialisé sur ces sujets. Nous voulions enfin qu’il y ait une dimension scientifique, une grande rigueur dans le traitement des données sur l’atome, les molécules, les bactéries, la réalité de ces contaminations.

Comment montrer ces contaminations ?
Pour alerter sur ces sujets, je tenais à ce que l’on soit sur quelque chose d’empirique, sans chercher les images d’horreur. Bien sûr, il y a des pollutions très spectaculaires, mais qu’il serait finalement possible de résorber à force de moyens financiers. Ici, la plupart sont complètement invisibles. C’est d’ailleurs ce qui est dramatique : comme on ne les voit pas, on a du mal à se les représenter. Il faut alors passer par le prisme scientifique qui nous permet d’avoir des chiffres, des données et des comptes-rendus qui viennent dialoguer avec les images.
Après, il y a la dimension photographique : comment rendre compte, comment donner à se figurer la contamination ? Comment l’imaginaire individuel peut-il parvenir à concevoir une chose comme les PCB, ces éléments extrêmement volatiles que l’on retrouve jusqu’en Arctique ? Il n’y a plus un mammifère qui n’en ait dans ses tissus. Les perturbateurs endocriniens, les substances cancérogènes que l’on respire, les produits du plastique… Quant à la radioactivité, on se figure peu l’impossibilité de cerner son danger. Pour travailler dessus, j’ai fait des séries de paysages très beaux, on dirait parfois des cartes postales… mais c’est vraiment le texte et les enquêtes scientifiques, politiques et sociales, qui permettent de saisir ce qui se joue derrière ces images.
Quels sont les moyens techniques et logistiques dont vous disposiez ?
Ce sont des moyens raisonnables. Il s’agissait d’un tour du monde, donc j’ai quand même pris des avions, des autos, je me suis rendu sur les lieux. Mais je n’ai pas utilisé de drones, je n’avais pas d’équipe technique. J’étais seul avec les journalistes du Monde. Nous avions préparé le travail avec une pré-enquête. Une fois sur le terrain, nous avons mené les interviews en- semble, cherché les gens, les lieux. Chacun a vraiment collaboré de manière à ce que le résultat soit le plus abouti possible.
Qu’en est-il des pressions politiques, des lobbies ? Vous a-t-on empêché l’accès à certains sites ? Dis- posiez-vous d’une relative liberté de mouvement ?
Nous n’avons pas eu trop de pressions. Le fait de travailler pour Le Monde était formidable parce que c’est une porte d’entrée. Lorsqu’on va voir les exploitants de Fukushima, ces derniers savent très bien qu’on écrira notre papier de toute façon. Ils savent aussi que s’ils ne nous permettent pas d’accéder à la centrale, de constater son état actuel et même d’entendre leur discours à eux, eh bien ils n’auront pas la parole et seront passés à côté de cette opportunité. Donc ils nous ont ouvert les portes. Nous avons pu rencontrer la plupart des interlocuteurs, du côté des lobbys et de ces puissances contaminantes.
En Russie, nous n’avions pas accès à ces endroits-là et il fallait travailler vite. C’est un pays où les journalistes locaux subissent des pressions énormes. Mais nous sommes passés entre les mailles, le FSB ne nous a pas ennuyés.
Finalement le sujet le plus dur et peut-être le plus risqué a été à Naples où la mafia est absolument impossible à cerner. Mais je n’ai pas subi des pressions pour autant. Après, il fallait aller sur les lieux, c’était parfois loin, parfois dangereux…
“Je me suis rendu compte à quel point la Terre était petite et fragile, c’est désarmant. “

À titre plus personnel, sur des projets de cette ampleur, avez-vous des appréhensions ou ressentez-vous de la peur ? Et comment garder l’espoir devant le spectacle de la désolation ?
Ce n’est pas de la peur. D’abord on apprend à identifier le danger pour ne pas s’y exposer trop longtemps. Évidemment, à Fukushima, nous avions des combinaisons, des compteurs actifs-passifs. Bien sûr, on ne va pas aller boire l’eau du canal où sont déversées des saloperies. Ce n’est pas vraiment de la peur, plutôt de la vigilance. Après, du point de vue du sujet, je ressens surtout de la désolation, comme lorsqu’on se dit « Les bras m’en tombent ». C’est tellement fou. C’est tellement violent et définitif, à l’échelle de la vie humaine, ce qu’on inflige à ces territoires et à ces populations. Et quand on voit l’inertie et la façon dont les choses ne bougent pas… Et tout cela avec Trump, Bolsonaro, Poutine, Erdogan, Xi Jinping, l’extrême-droite européenne… Ça ne va pas bouger demain.
Je me suis vraiment rendu compte à quel point la Terre était petite et fragile, c’est très désarmant. Je travaille depuis vingt ans sur des sujets sociaux très lourds. Mais je me suis toujours dit que même s’il s’agissait de ma société, j’avais la chance de ne pas vivre ce que vivaient mes sujets, la précarité du logement par exemple. Tandis que là, sur ce sujet, il n’est pas possible de se dire ça. Donc, est-ce que c’est déprimant ? En tout cas ce n’est pas de la dépression, c’est quelque chose de… C’est alarmant, désarmant. Je pense que le plus douloureux n’est pas l’angoisse de la finitude, c’est la sidération de ne pas pouvoir agir.

Une photo peut-elle encore changer l’histoire, un photographe peut-il faire bouger les consciences ?
Je n’ai pas la prétention de changer le monde… Je fais bien sûr ce métier avec des convictions et l’espoir d’y apporter ma contribution, mais nous ne sommes plus au XXe siècle où des photographes étaient capables de retourner l’opinion publique qui n’avait alors accès qu’à leur travail et à peu d’autres images. Aujourd’hui, le flot d’informations et d’images est tel que l’on ne peut pas prétendre à cette même épaisseur médiatique. Bien sûr, j’espère que mon livre ne servira pas à rien. C’est un livre qu’on envoie aux politiques, que l’on fait avec Greenpeace pour avoir plus de relais… C’est aussi mon métier que de chercher à donner le plus de visibilité possible à un projet, et ce sont autant de questions : la forme photographique, le choix des sujets, leur traitement, leur mode de diffusion… Ce sont les enjeux du métier de photographe aujourd’hui, parce que tout le monde produit des images. Si on en fait une profession, c’est pour leur donner un sens et une destination qui ne soient pas juste l’usage conversationnel du réseau social. Voilà, c’est ce à quoi je m’attelle. Après, ce que ça changera, je ne peux pas le savoir.

Après un tour du monde, quelles sont vos attaches parisiennes, en particulier dans le 10e arrondissement ?
J’ai toujours habité autour des 11e et 10e, jusqu’aux abords du 9e. J’ai toujours eu envie d’habiter le 10e parce que c’est un quartier qui est assez vivant. Mais il se gentrifie beaucoup malheureusement. J’espère que dans vingt ans ça ne sera pas le 3e arrondissement… si ça n’est pas déjà le cas. C’est un quartier dans lequel je suis bien. Je ne sais pas quoi dire de plus. Les rebondissements de ma vie ont fait parfois du 10e un refuge, alors voilà, j’y reste.
Avez-vous effectué un travail à un niveau plus local ?
J’ai travaillé deux ans avec « Les Morts de la Rue », un collectif qui essaie de récolter quelques informations sur les sans-abri retrouvés morts dans la rue. Avoir parfois juste un nom permet de ne pas enterrer la personne dans le carré des indigents ou de prononcer quelques mots sur sa tombe. Les gens du collectif essaient de parler au voisinage et de glaner des infos. J’ai fait tout un travail avec eux. Je photographiais des bouts de trottoir, les lieux sur lesquels ces gens avaient disparu. C’était accompagné de quelques lignes qui racontaient ces disparitions anonymes.
Ce travail a été montré dans le cadre des Rencontres photographies du 10e il y a deux ans. On a placardé dans l’arrondissement de grandes affiches de 4 mètres par 3. On réinstallait ces lieux dans l’espace public, de manière à ce que les gens s’arrêtent et prennent conscience ou se remémorent des histoires d’anonymes.
Quand on marche dans la rue, on voit tous ces gens, on ne leur parle pas à tous, on ne s’arrête pas systématiquement, et leur disparition vient révéler quelque chose d’un manquement collectif à notre humanité. Parce que ce n’est pas possible que des personnes meurent sous nos fenêtres, que cela devienne quelque chose de banal. C’était un projet très éphémère mais dont je suis très fier. D’avoir pu réinstaller cela dans l’espace public, dans le 10e. C’était ma façon de faire quelque chose dans mon quartier.